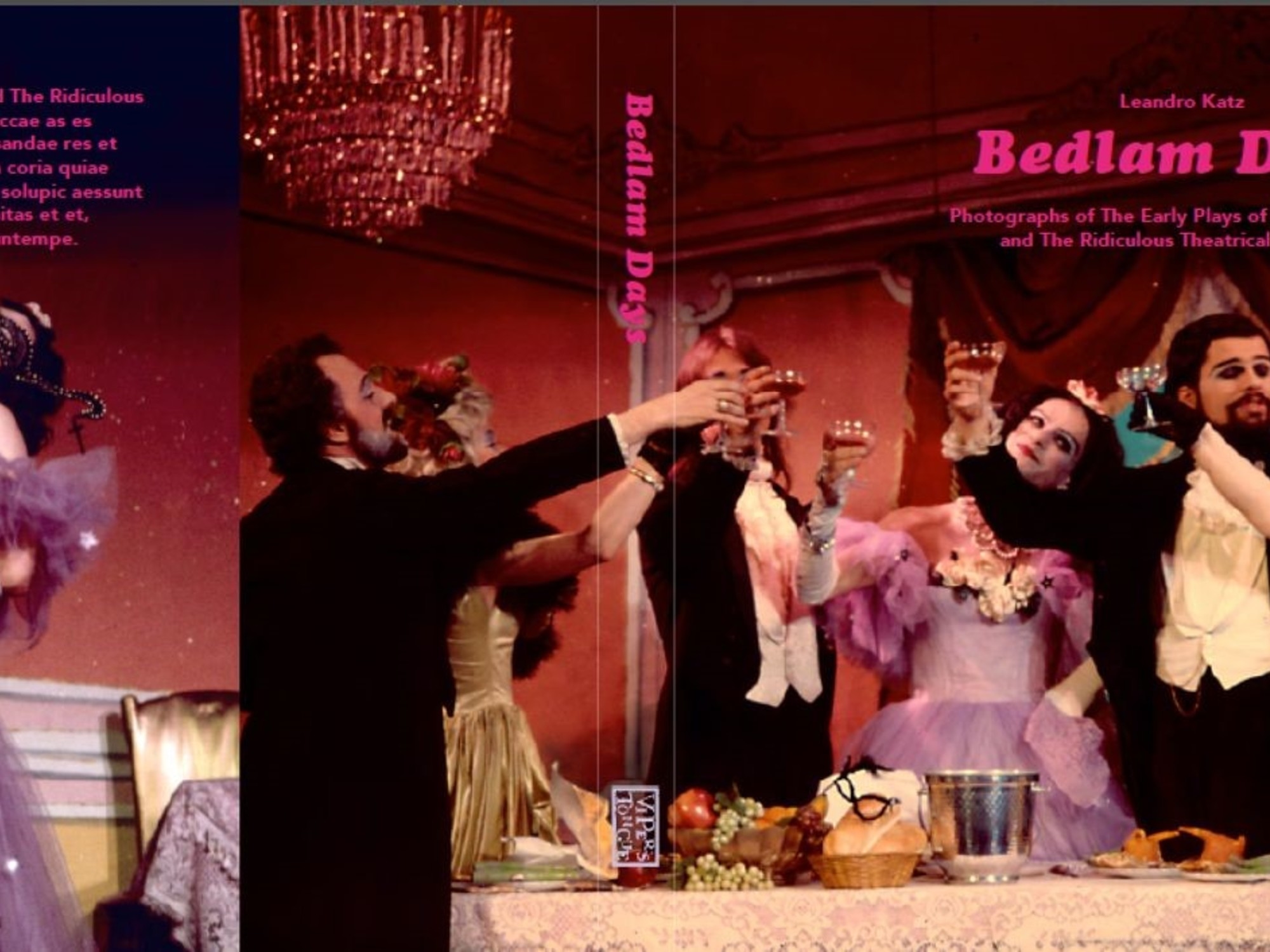Le tonnerre dans la pièce : le cinéma de Mikio Naruse

Le romancier Junichiro Tanizaki était profondément japonais à certains égards, et très peu à d'autres. Dans son essai secret sur la maîtrise – « une forme d'enchantement » –, il s'attache à donner des exemples tirés du théâtre, mais aucun du cinéma de son pays, bien qu'il mentionne ceux d'autres pays. (Avec quelques réserves : il perçoit Chaplin comme une figure attentive, calculatrice, froide et rationnelle : « J'admire son intelligence, mais il me semble être une personne à qui l'on ne peut faire confiance. ») Il est facile de s'identifier à la méthode de Tanizaki, qui consiste à assister à une représentation pour apprécier le talent d'un acteur favori sans trop s'intéresser au thème ou à l'intrigue. Il y a quelque temps, quelques-uns d'entre nous ont pu apprécier ici les nombreux exemples de maîtrise dans les films, les acteurs et les actrices de Mikio Naruse , grâce au Théâtre Lugones et au Musée Malba.
Face à la difficulté de retranscrire l'expérience de telles rétrospectives, on ne peut que griffonner des bribes de détails, glanés dans l'espoir que la mémoire et son fétichisme créeront un film parallèle. L'échange de places dès le début de chaque film – cette comédie chorégraphiée, provoquée par les retardataires qui obstruent la vue des spectateurs suivants et déclenchent un effet domino de changements de sièges – faisait parfaitement écho à la pantomime des sièges dans Hideko, le contrôleur (1941), passant de tous vides à tous occupés.
Adapté d'un roman de Masuji Ibuse , le film, réalisé en pleine guerre, est un véritable miracle : il parvient à faire rire près d'un siècle plus tard, à l'autre bout du monde, et on s'attendrait à tout sauf à ce qu'il s'agisse d'une adaptation. Une route déserte, des montagnes à l'horizon. La poussière et la chaleur accablante masquent la minutie visuelle. Une émission de radio donne au chauffeur et au contrôleur l'idée de jouer les guides pendant le voyage. Ils demandent l'aide d'un écrivain tokyoïte pour le texte. Il accepte gratuitement, car ils ont retrouvé et rendu un carnet qu'il avait oublié dans le bus. Dans un café-maison, l'écrivain se gratte les pieds nus. Il apprend au contrôleur à mémoriser ce qu'il a lu, à le réciter. Un aveugle monte à bord. Le chauffeur et le contrôleur – devenu guide certifié – échangent un sourire, comme si décrire le paysage était superflu (alors que c'est précisément à ce moment-là que c'est le plus nécessaire). Apprenant par téléphone qu'un accident impliquant le bus s'est produit, le directeur de la compagnie de transport demande au chauffeur de briser le pare-brise et le moteur afin de toucher l'assurance.
Dans L'Arrivée de l'automne (1960), un garçon fraîchement arrivé à Tokyo joue au baseball avec d'autres. Un vertige visuel : une balle lancée sur une trajectoire parfaitement horizontale. Circulation et chaleur. Hideo a apporté un scarabée dans la capitale et vit chez des parents dont il est livreur. Sa mère travaille dans un hôtel ; un vendeur de perles la séduit. Tokyo granuleux la nuit, en noir et blanc, les réverbères comme des flocons de neige. Une jeune fille de deux ans sa cadette tombe amoureuse de lui. Elle veut qu'il rejoigne sa famille. Ils refusent. Ils s'enfuient vers la mer. Un plan sublime les montre tous deux en équilibre, main dans la main, chacun sur une voie ferrée. Après plusieurs tentatives infructueuses pour retrouver un scarabée (le premier avait disparu), Hideo en attrape un par hasard parmi les pommes chez un autre marchand de fruits et légumes. Comme il l'avait promis à la jeune fille – elle en avait besoin pour l'école – il court le chercher, dans une séquence qui préfigure le dénouement grandiose des 400 Coups de Truffaut. La famille de la jeune fille a déménagé. Hideo retourne avec le scarabée au point d'observation où il l'avait rencontrée. Un scénario d'une grande fluidité, un film indomptable, l'un des plus beaux de l'histoire du cinéma.
Dans « Nuages flottants » (1955), adaptation d'un roman de Fumiko Hayashi, Hideko Takamine déploie une vaste palette de gestes, d'émotions et d'expressions, d'un réalisme saisissant. Elle se frotte doucement les mains en parlant ; ses genoux fléchissent légèrement. Des flash-backs évoquent sa relation en Indochine avec un garde forestier. Il lui montre un poème. Ils parlent de mourir ensemble dans les montagnes. La nuit, des bougies s'allument. Lui – photogénique, viril – lance deux dés en buvant et en discutant. Rues en pente, terrain accidenté, escaliers. Elle lui confie avoir lu « Bel Ami » à Hanoï et que cela lui a fait penser à lui. Deux personnes marchent seules et discutent (un thème récurrent dans l'œuvre de Naruse). Elles voyagent sur deux bateaux – deux voyages distincts – vers une île. Un film qui est une vie, traversant un brouillard blanc temporel. L'intensité dramatique de Naruse révèle une vérité évidente, amère et superbement mise en scène : après tant de rebondissements dans une relation, on ne sait plus vraiment ce que l'autre ressent jusqu'à sa mort. C'est le prix à payer pour qu'un déluge révèle une vérité.
« Chrysanthèmes tardifs » (1954) met en scène l'argent et l'infidélité, l'alcool et le tabac. L'héroïne confie à un ancien amant qu'elle a survécu à la guerre grâce à une amulette qu'il lui avait offerte. Une fois encore, le passé influence le présent. Naruse déjoue les attentes quant à la fin (qui se termine une fois de plus sous la pluie). Ce film à double fin s'inscrit dans la lignée des œuvres très cohérentes du réalisateur, marquées par des répétitions et des ritournelles.
Tel un coup de poing zen, Sudden Rain (1956) met à nu une autre vérité évidente – l’absence de chaises au Japon – tandis que les objets demeurent seuls dans le cadre : parapluies, lettres. La vie conjugale, avec une expressivité bien plus grande chez les femmes, et une scène inoubliable qui tient davantage de la solution que de la résolution : le couple ramasse le ballon qui a échappé aux voisins. La cohérence du film lui confère une qualité hallucinatoire qui révèle toute sa puissance une fois la projection terminée.
Dans Quand une femme monte l'escalier (1960), Takamine travaille dans un bar et apparaît d'une beauté saisissante, sublimée par de superbes plans sur sa silhouette (plus difficiles à réaliser que de magnifiques plans de paysage). La caméra est toujours placée légèrement en contre-plongée (pas directement face à l'actrice), mais pas aussi bas que dans les films d'Ozu. Un enchaînement incessant de plans intérieurs, sans mouvement de caméra. Plusieurs théières, certaines disproportionnées. L'argent est prêté et remboursé tout au long du film. Une diseuse de bonne aventure lui lit l'avenir en la regardant dans les yeux avec une bougie qu'elle déplace latéralement, et avec des cartes (la troupe de Naruse : un autre jeu de cartes limité, chaque personnage étant très expressif). Elle cache son carnet contenant un crayon avant l'arrivée d'un visiteur. (Tenait-elle un journal intime sans que le film ne le précise ? Était-ce la source des voix off occasionnelles ?). Un garçon à tricycle tourne autour de deux femmes dans un champ, tirant derrière lui un autre garçon qui traîne deux boîtes de conserve avec une ficelle. Celui qui conduit est trop grand pour tenir en équilibre sur un tricycle, mais peut-être Naruse nous suggère-t-il qu'il n'est pas si facile pour ses parents de lui acheter un vélo. Les retrouvailles de Takamine avec son partenaire de Nuages flottants , comme s'ils étaient amoureux depuis ce film. Des scènes finales indescriptibles.
Le Carnet d'une voyageuse (1962) – dont la voix off est composée des notes de l'auteure originale, Fumiko Hayashi – confirme que les femmes de Naruse – les hommes étant souvent lubriques ou sots – se comportent comme si elles n'étaient pas filmées. (Le secret de sa maîtrise ?). L'héroïne entre dans une librairie. Son amie lui dit qu'elle ne peut pas passer devant une librairie sans y entrer. Elle achète un recueil de poésie. « J'avais d'autres livres, mais j'ai dû les vendre. » Elle confie que ses auteurs préférés sont Heine, Whitman et Pouchkine. Sa façon de marquer une pause en écrivant ; sa façon de recouvrir l'encrier. Une autre amie lui dit qu'elle était belle lorsqu'elle écrivait à sa table. Elle évoque des souvenirs de son passé (elle a fréquenté sept écoles). Avec sa voisine de la pension, elles parlent des effets du travail sur leurs mains et leurs ongles.
Les commérages sont omniprésents dans les films de Naruse. Il y a toujours quelqu'un qui interrompt, qui fait irruption dans une pièce. De temps à autre, on entend un train. Elle dit que si elle devait se remarier, elle n'épouserait jamais un écrivain. Un collègue a dit que ses poèmes étaient comme une poubelle qu'on fouille et qu'on renverse. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas écrire « une histoire fausse ». Un autre dit : « Plus la montagne est haute, plus le vent est fort. » Finalement, son livre est publié et présenté. Celui qui l'a maltraitée le loue. Elle dit qu'elle veut en écrire un autre, pour que les gens ne pensent pas qu'elle est une auteure d'un seul livre, et parce qu'elle n'est pas ce seul livre, elle n'est pas tout à fait là. Dans l'avant-dernière scène, le voyou rondouillard — une figure indispensable dans les films de Naruse — qui l'aidait, réapparaît. Elle est dans une grande maison avec un jardin, avec un mari qui prend soin d'elle. Elle dit qu'elle cultive des azalées.
Dans son dernier film, Nuages épars (1967), la façon dont le mari tient un verre à deux mains est saisissante ; puis une main agrippe l’avant-bras opposé. La femme lui sert une bière, et il lui en sert une autre. Des détails subtils et mémorables dans un film d’une puissance inédite. Sous-jacente à tout cela, l’indécision, le moteur de ses scénarios. Un couple fait du bateau sur le lac Towada. Comme elle a de la fièvre, ils regagnent la rive. Il se met à pleuvoir. Tous deux sous un même parapluie ; l’un protège l’autre ; une comédie splendide et très brève, semblable à celle du papillon de nuit qui nage dans la soupe sans avancer.
La phénoménologie de Mikio Naruse atteint le sommet du cinéma pur grâce à une simple coupure de courant provoquée par un orage. La musique contribue à l'ambivalence de l'atmosphère, à la tension narrative du film, à ses allées et venues (littéralement, tant les changements sont nombreux). Le silence y est plus présent que dans aucun autre film. Tant de choses ont besoin d'un certain type de silence pour devenir crédibles.
Clarin